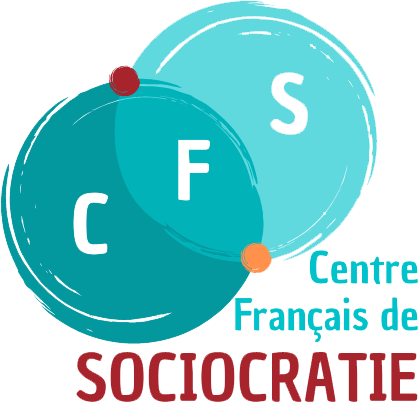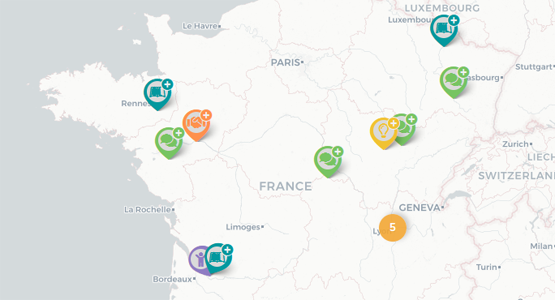L’Inspection Générale des Affaires Sociales – IGAS – a publié en juin 2024 un rapport intitulé : « Pratiques managériales dans les entreprises et politiques sociales en France : les enseignements d’une comparaison internationale (Allemagne, Irlande, Suède) et de la recherche. » (consultable ici)
Ce rapport de 95 pages 1 – hors annexes listées dans le tome 1 et présentées dans le tome 2 – est intéressant à plus d’un titre. Je retiens d’abord les deux affirmations suivantes :
“A l’issue de ces investigations, la mission dresse le constat, d’emblée contre-intuitif que les critères d’un management de qualité, loin d’être dispersés et hétérogènes selon les pays, les secteurs d’activité ou la taille des organisations, sont en réalité très convergents. Le « bon » management y est partout, et d’abord, décrit comme celui qui se caractérise par un fort degré de participation des travailleurs, d’une part, et qui assure la reconnaissance du travail accompli, d’autre part.” 2
“L’examen comparatif des pratiques managériales place la France dans une position peu flatteuse par rapport à ses voisins comme le montrent les enquêtes (…) et les analyses convergentes des chercheurs. Les pratiques managériales françaises apparaissent très verticales et hiérarchiques.”
Les auteurs du rapport pointent également que :
- “Il existe un consensus sur la réalité d’une crise du sens du travail, qui a fait l’objet de nombreux rapports administratifs, de travaux universitaires et de prises de position des acteurs importants du monde du travail, y compris des chefs d’entreprise.”
- “Il y a une demande sociale de faire évoluer les pratiques managériales exprimées par les organisations représentatives rencontrées par la mission, non seulement du côté des salariés mais aussi, selon des modalités différentes, du côté patronal, avec deux questions majeures que sont le dialogue professionnel et la codétermination.” 3
On peut ne pas souscrire à l’intégralité du rapport, par exemple quand les auteurs expliquent que “les raisons de ce consensus tiennent probablement aux impératifs de l’économie contemporaine” mais l’ensemble est très intéressant et mérite d’être lu.
Les recommandations finales sont évidemment des recommandations de politiques nationales à faire évoluer ou mettre en place, par exemple :
“Recommandation n°1 Organiser un rendez-vous des acteurs du travail permettant de prolonger les débats des Assises du travail autour de la question des pratiques managériales. Ce rendez-vous pourrait le cas échéant être une base de contenus pour une éventuelle négociation d’un accord national interprofessionnel.”
La limite de l’étude, de mon point de vue, c’est que l’analyse systémique des organisations est peu présente bien que l’environnement culturel et juridique soit pris en compte comme le montre par exemple le paragraphe consacré à “La dimension nationale qui est un paramètre important des pratiques managériales” dans lequel on trouve la citation des travaux d’Alain d’Iribarne 4 et notamment le tableau ci-après 5 :
| Caractéristiques de la logique culturelle | Logique de l’honneur (France) | Logique du contrat (États-Unis) | Logique du consensus (Pays-Bas) |
| Sens du devoir | Remplir les devoirs dictés par la coutume | Respecter fidèlement les termes du contrat | Chercher à s’accorder et respecter les accords passés. |
| Rapports hiérarchiques | Pluralité des rapports, opacité dans les relations | A l’image d’une relation client – fournisseur | Grande résistance aux pressions, transparence dans les relations |
| Perception du contrôle | Aversion envers le contrôle | Contrôle des résultats accepté | Contrôle perçu positivement. |
On comprend mieux à la lecture de ce tableau pourquoi la Méthode Sociocratique de Gouvernance est née au Pays-Bas et pourquoi il nous est difficile de la faire comprendre en France.
Pour conclure, en faisant le choix d’étudier le management, on fait porter aux managers la responsabilité des difficultés que rencontrent nos structures de travail. Or ces difficultés, grandement liées à la gouvernance de ces structures, pèsent aussi sur les managers. Elles se traduisent par l’épuisement de certains leaders, les reconversions professionnelles massives chez les encadrants et la désaffections pour les rôles hiérarchiques ou d’animation métier dont se plaignent certaines entreprises ou institutions.
Mais il ne faut toutefois pas se décourager, ce rapport de l’IGAS va dans la bonne direction, même s’il a fait le choix d’entrer dans le sujet du fonctionnement de nos organisations par le biais du management, sans doute plus facile à aborder. En effet, ses constats posent les bases d’une réflexion à mener dans chaque structure pour aligner gouvernance, organisation et politique managériale afin de répondre aux critères partagés du « bon management ».
Pierre Tavernier
- Pour ceux qui n’auront pas le courage de tout lire, la synthèse et les recommandations sont présentées dans les pages 2 à 8 et constituent un excellent résumé du rapport. ↩︎
- Rapport IGAS, tome 1, page 2 ↩︎
- Idem, page 4 ↩︎
- Idem, page 20 ↩︎
- Source : D’Iribarne, 1989 (à noter que ce tableau ne figure pas dans l’ouvrage « La logique de l’honneur » mais est repris par de nombreuses recherches). ↩︎